LES REINS


Les reins sont aussi importants pour votre santé que votre cœur ou vos poumons. Ce sont des organes vitaux sans lesquels on ne peut pas vivre. Mais le rein est un organe « muet » …il ne se manifeste que lorsque la maladie est déjà évoluée ! Le premier organe à être greffé fut le rein qu’Alexis Carrel, futur prix Nobel de médecine, transplanta sur un chien en 1908.Le rein est actuellement l’organe le plus transplanté. (environ 3500 greffes par an)
Anatomie
Les reins ont une architecture microscopique, l’essentiel n’est pas visible à l’œil nu. On y retrouve de toutes petites structures qui jouent un rôle majeur dans la filtration des déchets.
Le néphron est l’unité structurale et fonctionnelle du rein qui filtre le sang et intervient dans la formation de l’urine. Chaque néphron est constitué d’un glomérule et d’une capsule glomérulaire (capsule de Bowman).
Chaque rein contient environ un million de néphrons. Chaque néphron est constitué d’un glomérule (sorte de pelote de petits vaisseaux sanguins dont la paroi sert de filtre), entouré d’une structure à paroi fine, en forme de bonnet, la capsule glomérulaire ou capsule de Bowman. Le néphron contient également un petit tube, le tubule, qui évacue le liquide (qui devient peu après de l’urine) de l’espace situé dans la capsule de Bowman (l’espace de Bowman)
.Le néphron : l’unité structurale et fonctionnelle du rein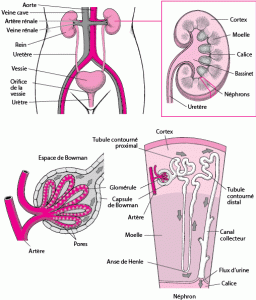
L’urine passe par les canaux collecteurs de plusieurs milliers de néphrons pour ensuite parvenir dans une structure caliciforme (le calice). Chaque rein possède plusieurs calices, qui conduisent l’urine vers une cavité centrale unique (le bassinet du rein). L’urine passe du bassinet de chaque rein dans l’uretère.
FONCTIONS DU REIN
Première fonction : filtration et épuration
Les reins filtrent les substances toxiques indésirables. Ils éliminent l’eau en excès via l’urine stockée dans la vessie avant d’être évacuée. Le sang épuré, quant à lui, quitte le rein pour rejoindre l’organisme.
D’où viennent les toxines ?
Les toxines sont des substances de type déchets. Elles sont issues du fonctionnement de la cellule. Ce sont, en quelque sorte, les déchets ménagers de nos cellules. Avant de se retrouver dans nos cellules, les toxines proviennent de différentes origines .
L’alimentation : Les repas trop lourds en graisses et en sucres, les colorants et conservateurs, mais aussi l’alcool, les exhausteurs de goût, les métaux lourds, les édulcorants…
Les agresseurs environnementaux : les médicaments, les pesticides, les polluants, les gaz de combustion, les gaz d’échappement, le tabac…mais aussi lest toxines internes celles issues des résidus de la digestion, de la respiration du stress et de l’anxiété.
Deuxième fonction : équilibre de notre milieu intérieur
En plus de cette fonction d’épuration, le rein assure l’équilibre « du milieu intérieur ». Cela signifie que le rein régule les quantités d’eau et adapte constamment les « sorties » (volume et composition de l’urine) aux apports (boisson et alimentation) et aux besoins de l’organisme.
Les reins régulent les quantités d’eau. Cette fonction d’équilibration porte essentiellement sur l’eau et les sels minéraux. Outre leur fonction d’élimination, les reins réabsorbent l’eau et les minéraux (calcium, magnésium, sodium, potassium…) dont les cellules ont besoin et les réinjectent dans la circulation sanguine.
Ça « fonctionne » comment ?
Lorsque le sang arrive aux reins par l’artère rénale, il passe à travers les glomérules, des pelotes de petits vaisseaux sanguins dont la paroi sert de filtre, où il est débarrassé de certaines substances. Les déchets (urée, acide urique ou créatinine et résidus de médicaments) et les éléments en excès sont éliminés dans l’urine.
Cette filtration permet en même temps de contrôler la teneur en eau et en ions (sodium, potassium, calcium…) du sang et de la maintenir à l’équilibre.
En 24 heures, ce sont 150 à 180 litres de plasma sanguin qui sont filtrés pour la production d’environ 1 litre à 1,8 litres d’urine. L’urine est au final composée d’eau et de solutés (sodium, potassium, urée, créatinine…). Certaines substances ne sont pas, chez un patient sain, présentes dans l’urine (glucose, protéines, globules rouges, globules blanc, bile).
Troisième fonction : régulation de la tension artérielle 
Les reins permettent la régulation de la tension artérielle, en produisant une enzyme appelée rénine. Lorsque la tension artérielle tombe en dessous des niveaux normaux, les reins sécrètent de la rénine dans la circulation sanguine pour activer le système rénine-angiotensine-aldostérone, lequel entraîne une augmentation de la tension artérielle.
Les reins produisent également l’urotensine, qui entraîne la constriction des vaisseaux sanguins et permet l’élévation de la tension artérielle. Les personnes en insuffisance rénale présentent une diminution de la capacité à réguler la tension artérielle et tendent à être hypertendues.
Quatrième fonction : nos reins produisent des hormones et des vitamines
L’Erythropoïétine bien connue de certains « sportifs » sous le vocable d’EPO. Les reins fabriquent des hormones comme l’érythropoïétine (EPO) qui commande à la moelle osseuse la fabrication des globules rouges. Ceux-ci sont chargés du transport de l’oxygène dans le sang.
La rénine et l’angiotensine, deux hormones impliquées dans la régulation de la pression artérielle.
La Vitamine D. Les reins transforment également la vitamine D de façon à la rendre active. C’est grâce à cette vitamine que les os peuvent capter le calcium, nécessaire à leur solidité.
Synthétisée par la peau sous l’action des UVB du soleil et stockée dans les muscles et le tissu graisseux, la vitamine D joue un rôle crucial dans l’absorption et la fixation du calcium et du phosphore, contribuant à la bonne santé des os et des dents. Elle a aussi un rôle important pour les fonctions musculaire et immunitaire.
Que se passe-t-il lorsque les reins fonctionnent mal ?
Lorsque les reins souffrent les dommages collatéraux pour l’organisme peuvent être importants :
Une hypertension artérielle : puisque les reins contrôlent l’eau et le sel dans l’organisme, leur dysfonctionnement entraîne une de l’hypertension artérielle.
Une anémie : Si les reins ne fabriquent plus assez d’EPO, le taux de globules rouges baisse.
Des maladies cardiovasculaires : dès que la fonction rénale tombe à 30 % de sa capacité, le risque d’infarctus et d’AVC augmente sérieusement.
Une surdose de médicaments : si les reins n’assurent plus leur rôle de filtration, la concentration sanguine en molécules actives peut s’élever dangereusement.
De l’ostéoporose : quand la vitamine D n’est pas suffisamment synthétisée par les reins, l’organisme ne dispose plus suffisamment de calcium pour protéger les os.
L’insuffisance rénale
L’insuffisance rénale diminue la capacité du rein à maintenir l’homéostasie liquidienne et électrolytique. La capacité à concentrer l’urine décline précocement et est suivie par une baisse de la capacité à excréter l’excès de phosphate, les ions acides et le Potassium.
L’insuffisance rénale résulte de l’évolution lente de maladies qui conduisent à la destruction des reins. Elle concerne plus de 82 000 personnes en France et nécessite le recours à la dialyse ou à la transplantation. Dans 50% des cas, les maladies rénales chroniques qui conduisent à l’insuffisance rénale sont la conséquence d’un diabète ou d’une hypertension artérielle.
Stades de la maladie rénale chronique : La maladie rénale chronique a été classée en 5 stades.
Stade 1 : taux de filtration glomérulaire normal (≥ 90 ml/min/1,73 m2) accompagné soit d’une albuminurie persistante ou d’une néphropathie héréditaire connue, structurelle
Stade 2 : taux de filtration glomérulaire de 60 à 89 ml/min/1,73 m2
Stade 3a : 45 à 59 ml/min/1,73 m2
Stade 3b : 30 à 44 ml/min/1,73 m2
Stade 4 : taux de filtration glomérulaire de 15 à 29 ml/min/1,73 m2
Stade 5 : taux de filtration glomérulaire < 15 ml/min/1,73 m2
Créatinine et urée
Quand le Taux de Filtration Glomérulaire devient inférieur à 15 ml/min/1,73 m2 (normale > 90 ml/min/1,73 m2), les taux de créatinine et d’urée sont élevés et sont habituellement associés à des manifestations systémiques (urémie).
L’urée et de la créatinine ne sont pas les principaux contributeurs des symptômes urémiques; les autres marqueurs (certains non encore bien définis) pouvant entraîner une symptomatologie sont mal définis.
La dialyse :
Depuis près de 50 ans, la dialyse a sauvé des dizaines de milliers de vies en France. C’est un traitement de suppléance qui débarrasse le sang des déchets et de l’eau (ou toxines) accumulés en excès dans le corps. Puisque les reins ne fonctionnent plus, une fois la séance de dialyse terminée, les toxines et les fluides recommencent à s’accumuler dans l’organisme. Pour cette raison, la dialyse doit être répétée de manière régulière, à un rythme qui varie en fonction des techniques mais qui est au moins de 3 séances de 4 heures minimum par semaine. La dialyse peut être réalisée à domicile ou dans un établissement de soins.
Actuellement 46 000 patients sont traités par dialyse.
La transplantation rénale : La greffe de rein, lorsqu’elle est possible, est évidemment le traitement de choix de l’insuffisance rénale terminale. Chaque année, en moyenne, 3 600 greffes rénales sont réalisées, alors que plus de 13 000 patients sont sur la liste d’attente ! C’est dire combien ce « petit greffon » est précieux et requiert tous nos soins.
Or, en 2020, les transplantations rénales ont diminué de 29 % !
Les 9 ennemis des reins
Le rein reste un organe mal connu dont le rôle dans l’organisme est souvent sous-estimé. Lorsqu’il ne fonctionne plus bien, la maladie reste longtemps silencieuse. Les symptômes de souffrance ne surviennent en effet que lorsque la fonction rénale a chuté à moins de 10 % de sa capacité. Puis, peut apparaître une insuffisance rénale, qui peut évoluer vers une insuffisance rénale chronique terminale. (voir ci-dessous).
Aussi, pour garder ses reins en bonne santé et limiter le risque de maladie, mieux vaut donc connaitre leurs ennemis.
- L’Hypertension artérielle: organe très vascularisé, le rein ressent en direct toute hausse de la pression artérielle. Et, d’une manière générale toutes les maladies des artères affectent les reins.
- Le diabète: lorsqu’il est mal contrôlé l’excès de sucre dans le sang « encrasse » les reins ce qui oblige ces derniers à fonctionner au-delà de leur capacité.
- L’obésité : la graisse peut exercer une pression néfaste sur les glomérules (les filtres rénaux). Par ailleurs, l’obésité est souvent liée à l’HTA et au diabète, principaux facteurs d’insuffisance rénale.
- Une hydratation insuffisante : pour que les reins filtrent bien les toxines il faut leur apporter de l’eau en quantité suffisante : 1,5 à 2 litres par jour en cas de chaleur ou de transpiration.
- L’excès de protéines animales: la filtration des acides aminés issus de la dégradation des protéines animales oblige les reins à produire un effort supplémentaire. Trop de protéines mettent les reins « en surchauffe ».
- Le tabac: en endommageant les artères (inflammations, formation de caillots) il met les reins en danger. La cigarette est aussi un facteur de risque connu de cancer des cavités rénales.
- Certains médicaments: les anti-inflammatoires non stéroïdiens pris pendant plusieurs semaines réduisent le calibre des artères rénales, ce qui fait monter la pression à l’intérieur du rein. De même, la prise au long cours d’inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) contre les brûlures d’estomac, les immunosuppresseurs affectent aussi la fonction rénale.
- Les pesticides : une exposition chronique aux pesticides et herbicides est soupçonnée d’affecter les reins (favoriser une alimentation issue de l’agriculture biologique).
- Les solvants et les métaux lourds : les professionnels exposés au trichloroéthylène, au cadmium, au plomb et aux hydrocarbures (métallurgie, chimie…) ont plus de risques de cancer du rein.
QUE FAIRE POUR PROTEGER SES REINS ?
La santé rénale ne fait pas exception à cette règle d’or de la prévention : avoir une bonne hygiène de vie. Notamment une alimentation saine : ce que vous mangez a un effet sur les reins, dont l’une des fonctions est d’éliminer les déchets.
Le saviez-vous ? A partir de 40 ans, la filtration rénale commence à diminuer d’environ 1% par an. A long terme, le risque est de développer une maladie rénale, d’autant plus sournoise qu’elle évolue silencieusement. Au stade de l’insuffisance rénale, les conseils personnalisés d’une diététicienne sont nécessaires. Avant d’en arriver là, quelques points méritent une attention particulière.
Au niveau du sel : manger trop salé favorise l’hypertension artérielle et certaines formes de calculs rénaux. La population française a en moyenne une consommation trop élevée de sel (environ 8 à 9 g par jour). Un maximum de 6 à 7 g par jour conviendrait mieux à la santé des reins. Pour rehausser le goût des plats, on peut facilement remplacer le sel par des épices ou des aromates.
1 g de sel correspond à 60 g de jambon cuit ou 60 à 80 g de pain ou 200 g de légumes en conserve
Au niveau du calcium : le calcium contribue à la régulation de la pression artérielle. Il est donc indispensable, même chez les personnes sujettes aux calculs rénaux calciques. Les apports recommandés sont de 900 milligrammes par jour. La seule précaution à prendre est de bien répartir ses apports en calcium tout au long de la journée.
150 mg de calcium correspondent à 1 verre (150 ml) de lait demi-écrémé ou 1 yaourt (125 g).
Des fruits et légumes à chaque repas apportent 200 à 300 mg de calcium par jour.
L’eau du robinet contient en moyenne 100 mg de calcium par litre. Les eaux minérales Contrexéville, Hépar ou Courmayeur contiennent 500 à 600 mg de calcium par litre
Au niveau des protéines : pour ne pas surcharger les reins en déchets, tout en assurant les besoins de l’organisme, il faut absorber chaque jour l’équivalent de 1 g de protéines animales par jour et par kilo de poids . Pour que le corps puisse les assimiler sans augmenter le travail des reins, il vaut mieux fractionner les apports en protéines lors des trois repas de la journée.
Par exemple : : une escalope de poulet de 120 g fournit 32 g de protéines ; un steak haché de 100 g, 26 g de protéines ; une tranche de jambon de 40 g, 10 g de protéines ; une portion de 150 g de saumon frais, 34 g de protéines ; un yaourt, 5 g de protéines ; une portion de camembert de 30 g, 6 g de protéines. Et d’une façon générale éviter une alimentation trop riche en protéines le soir. Car la nuit on ne boit pas, donc on n’aide pas les reins à éliminer les toxines des protéines, surtout celles d’origine animale.
Il est préférable de privilégier les protéines végétales : le pain, les pâtes les légumineuses (haricots, lentilles, le soja). Pour ce qui concerne les protéines végétales, il faut associer les céréales et les légumes secs pour retrouver tous ces éléments de base », dit Marie-Paule DOUSSEAUX, diététicienne-nutritionniste du service de Néphrologie de la Pitié Salpêtrière ».
Par exemple : 5 g de protéines végétales correspondent à 70 g de pain ou 50 g de lentilles cuites ou 100 g de pâtes cuites.
Boire assez d’eau : l’organisme a besoin de 1,5 litre d’eau par jour, en moyenne. En général, il n’y a pas besoin d’aller au-delà de cette recommandation sauf en cas de forte chaleur, de transpiration ou de diarrhée. Autre exception : les personnes qui ont tendance à souffrir d’infections urinaires ou de calculs rénaux doivent diluer davantage leurs urines et, pour cela, boire environ 2 litres par jour. Dans ce volume, on inclut non seulement l’eau, mais aussi le thé, le café, les infusions et tous les liquides à condition qu’ils soient sans sel ou sucre ajouté.
Et…une activité régulière : dans l’idéal 30 minutes de marche chaque jour. Toutes les formes de mouvement du corps sont bonnes : le vélo, la danse… améliore la capacité rénale à filtrer le sang et diminue le risque de la présence d’albumine dans les urines.


