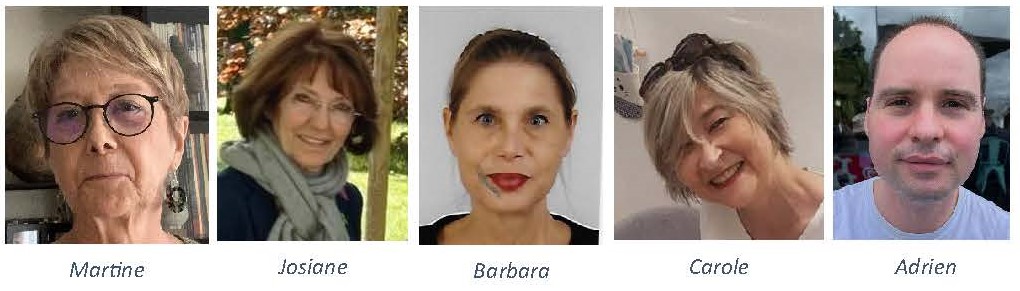Avant de pouvoir être inscrit sur la liste de transplantation, un bilan pré-greffe doit être réalisé. Ce bilan a pour objectif de répondre à trois questions :
- la greffe est-elle réalisable et dans quel délai ?
- quels en sont les risques à court et moyen terme ?
- quel est le traitement immunosuppresseur le plus adapté ?
Pour cela un bilan médical complet doit être réalisé pour répondre à ces questions. Un examen cardiovasculaire complet (épreuve d’effort, échographie cardiaque, doppler des artères, …), un examen des voies urinaires (scanner abdominal, échographie abdominale ..), un bilan infectieux, et autres examens jugés pertinent par l’équipe de transplantation sont nécessaires.
La délivrance d’une information par l’équipe médicale sera faite sur le parcours avant la greffe, sur la réalisation de la greffe, les contre-indications, le traitement immunosuppresseur ; le suivi et les effets indésirables.
L’équipe de transplantation procède à une étude minutieuse du dossier au terme du bilan. En fonction des résultats, il est possible que des traitements préalables à la greffe soient proposés, par exemple une intervention chirurgicale (ablation d’un rein en cas de polykystose rénale, traitement d’un anévrisme de l’aorte, etc.) ou l’éradication d’un foyer infectieux (sinusite chronique, abcès dentiares, caries…). S’il n’y a pas de contre-indication, le patient est inscrit sur la liste de transplantation rénale de l’Agence Nationale de Biomédecine.